Des pistes pour contribuer à rapprocher les paysan·nes et les citoyen·nes-mangeur·ses
Les agriculteur·ices, en France mais aussi ailleurs en Europe, grognent et se révoltent. Notre modèle agricole européen s’essouffle. Les agriculteur·ices portent des revendications communes, mais aussi des demandes spécifiques en fonction du type d’agriculture qu’ils et elles pratiquent. En quoi leurs revendications nous concernent-elles, en tant que citoyen·nes et mangeurs ? Sur quels enjeux pouvons-nous faire alliance avec le monde paysan.
Au fil de nos rencontres et des échanges avec des personnes qui vivent la précarité alimentaire, des acteurs de l’aide alimentaire, mais aussi des paysan.nes et des organisations qui œuvrent au quotidien pour transformer le modèle agricole productiviste, nous avons, à Aequitaz, renforcé notre conviction d’une nécessaire alliance « entre les mondes ». Comprendre ce qui se joue pour chacun·e, en particulier les agriculteur·ices, permet de mieux penser notre interdépendance, les débats qui nous traversent et la nécessité d’ouvrir ensemble des espaces de dialogue démocratiques. Ce texte s’adresse aux mangeur·euses qui ont faim de justice sociale.
Un monde paysan divisé
Parmi les revendications qui font l’unanimité dans le monde agricole, nous pouvons retenir que le revenu des agriculteur·ices est trop faible, et nombreux sont ceux qui vivent mal de leur métier. Ils s’épuisent au travail et doivent souvent faire un second métier. Un agriculteur·ice sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Les agriculteur·ices se sentent maltraités et leur taux de suicide est beaucoup trop élevé. La colère est attisée par des retards de versement des subventions de l’UE (surtout pour ceux qui en touche le plus), par l’inflation qui touche principalement les produits transformés de la grande distribution et par la concurrence déloyale de produits venant de pays ayant des normes sanitaires et environnementales bien moins élevées que les nôtres. Tous les agriculteur·ices partagent également un ras-le-bol vis-à-vis de la En 2022, 1786 décrets réglementaires, contenant plus de 10 000 articles ont été ajoutés au droit agricole. Les haies, qui font la une des médias, sont soumises à des dizaines de réglementations différentes¹.
C’est sur l’avenir de notre modèle agricole et le rôle des agriculteur·ices que la colère se sépare comme les deux bras d’un fleuve qui prendraient des directions différentes. Les syndicats majoritaires (FNSEA, Jeunes agriculteurs, Coordination rurale), représentatifs des exploitant·es agricoles, demandent une baisse des normes environnementales – sur les pesticides, l’obligation des jachères… – pour être de nouveau compétitifs, pouvoir exporter et maintenir un modèle agricole libéral dans un marché mondialisé.
Les syndicats représentatifs des paysan·nes (Confédération paysanne, Mouvement de défense des Exploitants familiaux) partagent des revendications sur le revenu des paysan·nes et le décalage technocratique avec Bruxelles. Cependant, ils souhaitent que la crise actuelle soit l’opportunité d’un changement de modèle agricole et d’une accélération de la conversion de notre agriculture à une agro-foresterie plus respectueuse de l’environnement, mais aussi de la santé des consommateur·ices comme des paysan·nes. Depuis 1994, l’Organisation Mondiale du Commerce a intégré les produits agricoles dans les accords de libre-échange. Cela a permis à l’agro-industrie d’augmenter ses exportations et ses importations (et ses marges), soumettant les agriculteur·ices à plus de concurrence venant de pays où les lois sociales (niveaux de salaires, etc…) et environnementales sont moins contraignantes. Aujourd’hui, la France est dépendante à 50% de l’Amérique Latine pour la nourriture des animaux d’élevage, à 40 % d’engrais importés directement ou indirectement pour sa production agricole, importe 70% de ses fruits et 30% de ses légumes. En France, un camion sur trois transporte des denrées alimentaires.
De nombreux·ses citoyen·nes – parmi lesquel·les les paysan·nes aujourd’hui minoritaires dans les chambres d’agricultures – revendiquent une alimentation qui soit :
– Bonne pour la santé de celle·eux qui la consomment,
– Bonne pour la santé de celle·eux qui la produisent,
– Viable pour la planète et les générations à venir.
Cette voix que nous rejoignons, nous appelle à entendre leurs arguments et les défis qui en découlent

Comprendre les enjeux de chacun·e pour mieux se comprendre
C’est en nous saisissant collectivement des questions alimentaires et agricoles, en alliance avec des paysan·nes, que nous parviendrons à changer notre modèle alimentaire et agricole.
La longue route de la relocalisation de notre alimentation
Chaque pays, chaque région, devrait pouvoir progresser pour mieux couvrir ses besoins alimentaires : c’est à cela en priorité que les politiques agricoles devraient mieux répondre². Cela limiterait le nombre de camions sur les routes, les aléas climatiques ou géopolitiques, et notre dépendance à des grandes entreprises qui « mangent » la plus grande partie des bénéfices du commerce alimentaire. Cela ne veut pas dire que nous ne soyons pas solidaires de pays et régions où les conditions de productions sont plus difficiles, voir que nous importions en quantité raisonnables des aliments qui ne peuvent être produits chez nous.
Installer – Accueillir de nouveaux·elles paysan·nes
Pour cela, nous avons besoin de plus de paysan·nes pour cultiver les terres et bien s’occuper des animaux d’élevage. Depuis 1980, 800 000 fermes ont disparu. Les conditions d’accès à la terre et la taille des exploitations découragent l’installation des jeunes, alors que nous avons besoin de soutenir l’installation de nouveaux·lles paysan·nes dans des exploitations à taille humaine. Il serait important de mieux reconnaitre aux paysan·nes leur rôle central de production de notre alimentation mais aussi dans le maintien de la biodiversité et l’entretien des paysages. Ce rôle pourrait être mieux soutenu par les pouvoirs publics car c’est de biens communs dont nous parlons. A l’échelle locale, les luttes citoyennes ou les projets portés par des collectivités pour installer des maraicher·es sont à soutenir par exemple.
Nos régimes alimentaires à réinventer
Nous devons accepter de remettre en question nos habitudes alimentaire et opérer des changements dans nos régimes alimentaires. Par exemple, notre alimentation est aujourd’hui trop dépendante du blé (saturé en pesticides), du lait de vache (nourries au maïs, parfois OGM, qui poussent grâce à des pesticides, trop riche en oméga 6) et de viande bovine (grands consommateurs de terres pour leur alimentation). Une alimentation plus végétale, avec plus de légumes et de légumineuses, et une consommation animale maîtrisée, d’animaux de plus petite taille serait meilleure pour notre santé et permettrait de mieux préserver les terres et la biodiversité. Ces efforts conjoints, tant des producteur·rices que des mangeur·ses doivent se poursuivre.
La dépendance à la technologie, aux intrants et aux exportations
A terme, notre agriculture devra sortir de sa dépendance au pétrole et aux intrants (engrais fabriqués à partir de phosphates et d’hydrocarbures). Les technologies qui permettent de limiter l’impact négatif de l’agriculture sur les sols (labours qui épuisent les sols) ou l’usage de l’eau ne sont pas une alternative crédible et suffisante à long terme. L’agro-foresterie, qui combine agriculture au sol, vergers et petits élevages, et l’agriculture biologique sont des alternatives possibles. L’enjeu de changement de modèle est de taille. Du côté consommateur·ice, quid de nos habitudes de consommation, de l’import massif de denrées et de la part de produits manufacturés dans nos caddys ? Comment amorcer un sevrage progressif à cette économie de la bouffe mondialisée ? La révolution dont on parle doit-elle se faire avec / pour / contre la grande distribution ?
Le choix de nos aliments : un enjeu de justice sociale
Nous avons enfin et surtout besoin que tout le monde puisse accéder à une alimentation choisie et de qualité, et pas seulement celle·eux qui ont les revenus suffisants pour accéder à ces produits. Ce n’est pas seulement l’évolution de nos modes de consommation vers la bio, vers les produits locaux ou sains, qui pourra faire évoluer le système de production. Ce n’est pas seulement l’effort des paysan·nes pour produire et distribuer autrement, en circuit court, des produits de qualité et utiles au plan nutritif qui suffira non plus. Nous ne pouvons pas continuer avec un marché de l’alimentaire à trois vitesses : des produits de qualité pour celle·eux qui ont le plus de moyens ; des produits de moins bonne qualité mais peu chers pour ceux pour qui les fins de mois peuvent être difficiles ; les invendus pour les plus pauvres à travers l’aide alimentaire.
Ces quelques éléments n’épuisent pas l’ensemble du sujet³ mais éclairent les tensions qu’il nous faudra résoudre, en se mettant à chaque fois, du côté du modèle agricole dans sa dimension tant écologique qu’économique, comme du côté citoyen dans sa dimension démocratique et sociale.
Construire des choix collectifs : l’impératif démocratique pour nous relier.
Nous devons penser l’alimentation comme un bien commun et le droit à l’alimentation comme un droit qui doit plus que jamais être effectif. Car pour décider ensemble de l’avenir de notre alimentation, il nous faut créer des espaces démocratiques ouverts de débat et de décision qui puissent s’emparer de ce sujet. On doit parler agriculture ailleurs que dans les chambres d’agriculture et de commerce, que dans les ministères ou les salons feutrés de Bruxelles. Une convention citoyenne de l’alimentation, suivi de décisions, pourrait permettre d’élargir les débats et d’écouter celle·eux que l’on n’entend pas assez aujourd’hui. A l’échelle locale, nous sommes partis prenantes des tentatives d’ouvrir les débats par la mise en place d’assemblées citoyennes, d’expérimentations inspirées de la sécurité sociale de l’alimentation et d’alternatives alimentaires qui associent producteurs et consommateurs dans des choix communs.
En France, nous devons nous relier, comprendre et débattre ensemble de ce sujet : jeunes en quête de s’installer comme paysan·ne, éleveur·ses pris dans la spirale de la dépendance aux aides européennes, bénéficiaire de l’aide alimentaire, parents payés au SMIC habitant les quartiers en relégation des grandes villes, habitant·es de la ruralité privés d’accès aux commerces alimentaires… Le débat doit avoir lieu : comment mieux nous nourrir ? comment préserver la dignité et le choix de chacun·e qu’il soit producteur·rice ou mangeur·se ? Cette révolution sera difficile et longue à mettre en place. Mais nous avons, à la condition d’accepter la conflictualité du jeu démocratique, non seulement un rôle à jouer mais aussi une responsabilité à assumer.
[1]Divergences et représentations dans les mondes agricoles : le mouvement des agriculteurs de 2024, Note Parlons Climat
[2]La Métro de Lyon, en 2019 a une autonomie alimentaire de 4,6%, avec un objectif de 15% à horizon 2030. L’île de France a 6% d’auto-suffisance alimentaire.
[3]https://www.secours-catholique.org/agir/porter-nos-messages/linjuste-prix-de-notre-alimentation
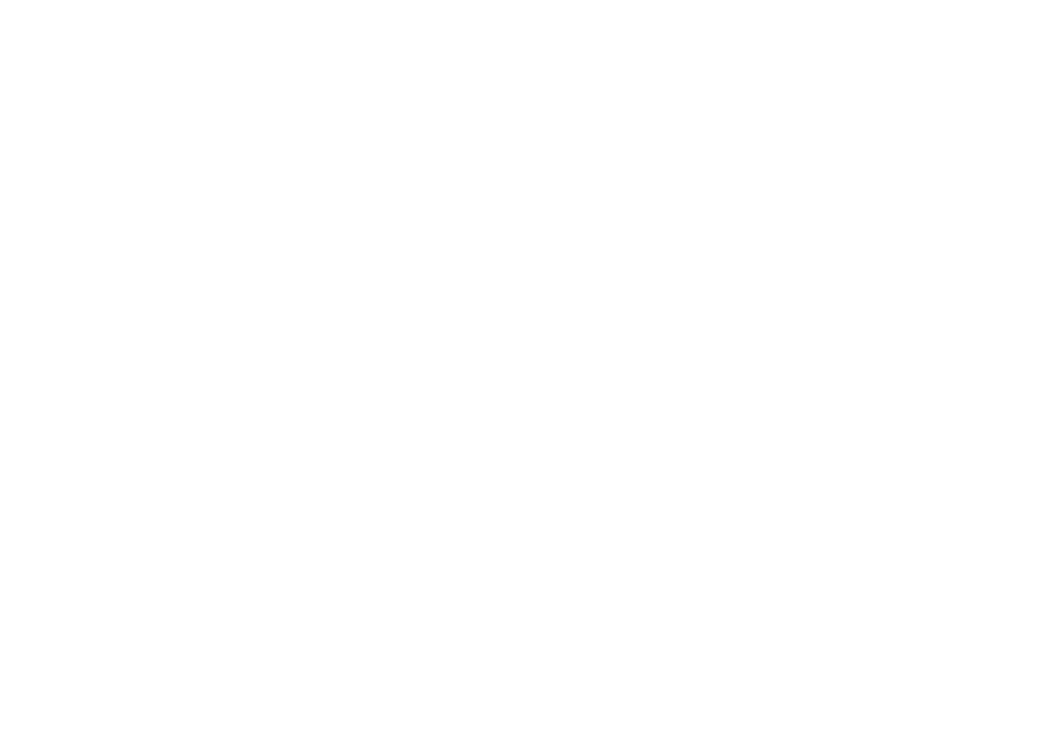

 |
|